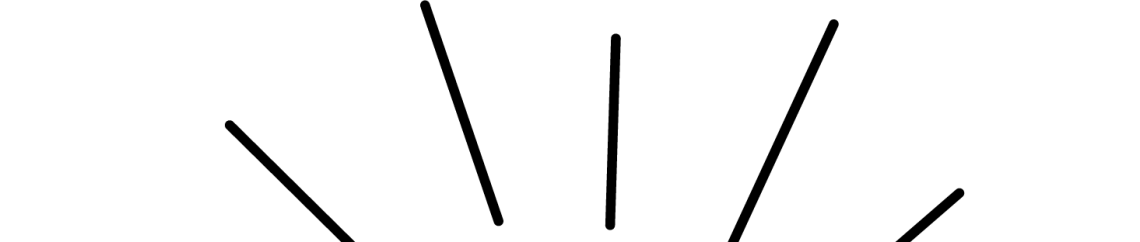La science-fiction offre parfois un aperçu de ce à quoi ressemblerait notre vie si les pouvoirs publics ne déployaient pas tant d’énergie et de moyens pour la défense du patrimoine, de la création artistique, des pratiques culturelles et de leur diversité.

Dans Equilibrium, de Kurt WIMMER, Christian BALE joue le rôle d’un magistrat rebelle de Libria, une société où règne le calme et la paix. La recette ? Tous sont contraints de prendre quotidiennement une dose de Prozium, une puissante drogue qui stabilise le mental en éliminant tout sentiment de violence mais aussi de joie et de bonheur. Dans ce monde, les œuvres d’art – puisqu’elles suscitent des émotions – sont donc proscrites et détruites.
Equilibrium, comme beaucoup d’autres récits de ce genre, présente ce que les économistes appellent une « situation contrefactuelle ». Cette notion est au cœur de l’évaluation des politiques publiques : évaluer, c’est comparer une situation observée une fois une mesure mise en place avec celle que l’on observerait en l’absence d’intervention publique.
Le secteur culturel n’est pas vierge de ce type de démarches ; je l’ai expérimenté lorsque je travaillais à la Mairie de Paris, il y a quelques années de ça. Mais au-delà de la démarche d’évaluation en elle-même, c’est surtout son impact managérial qui a été un enseignement fondateur dans mon approche du management.
En l’occurrence, tout a commencé par un vol de tableaux dans la nuit du 20 mai 2010.
Un vol de tableau au musée !
« Cinq tableaux de maître ont été volés dans la nuit de mercredi à jeudi au Musée d’art moderne de la Ville de Paris. » Le Monde, édition du 21 mai 2010
A l’époque, l’événement avait fait la Une des quotidiens : « il s’agit d’œuvres des peintres Pablo Picasso, Fernand Léger, Henri Matisse, Georges Braque et Amedeo Modigliani. Selon une source judiciaire, les œuvres disparues sont Le Pigeon aux petits pois, de Picasso, La Pastorale, de Matisse, L’Olivier près de l’Estaque, de Braque, La Femme à l’éventail, de Modigliani et Nature morte aux chandeliers, de Léger. La valeur estimée de l’ensemble de ces toiles diffère selon les sources : 100 millions d’euros selon la direction du musée, 500 millions d’euros selon le parquet de Paris. »
Très vite, les investigations ont mis en lumière un défaut de surveillance technique du Musée – un établissement public qui dépendait de la Mairie de Paris. La crise n’était pas isolée et circonscrite au seul secteur du patrimoine : au même moment, la Ville devait faire face à la situation financière de plusieurs lieux de création artistique qu’elle finançait : théâtres, lieux pluridisciplinaires, etc.
Alors, comment a-t-on pu en arriver là ?
Flashback sur une histoire de la création artistique parisienne

En 1977, année de création de la Ville de Paris en tant que collectivité territoriale, un certain nombre de grosses institutions culturelles existaient déjà. De nouvelles structures comme les théâtres municipaux ont ensuite été créées. Mais après un certain ralentissement dans la création de nouveaux équipements, c’est au début des années 2000 que la ville a connu une nouvelle impulsion.
L’ambition : gagner de nouveaux publics, conquérir de nouveaux territoires – physiques et imaginés, réduire la fracture culturelle.
L’envers du décor : un certain nombre d’établissements supplémentaires, des champs artistiques nouveaux, des modèles économiques inédits, des structures juridiques qui se sont diversifiées… bref, un nouvel écosystème professionnel. Et les premières crises liées à une relation complexe et parfois défaillante entre la collectivité et ces structures.
De l’évaluation au plan d’action
Ces fragilités ont logiquement conduit à ce que la Mairie s’interroge sur le risque global lié à la tutelle, c’est-à-dire à la relation entre la collectivité et les structures qui contribuent à la mise en œuvre de la politique culturelle.
La méthodologie s’est alors articulée en 3 étapes successives:
- Un audit global de la politique culturelle, commandé à un cabinet externe – afin de bénéficier d’un diagnostic objectif et de mettre en lumière les principaux sujets à traiter,
- Un diagnostic plus fin réalisé en interne sur ces sujets saillants, avec une identification et une cotation des principaux risques identifiés pour la Ville (risques financier, patrimonial, médiatique, opérationnel, etc.),
- Un plan d’action hiérarchisé et progressif pour mieux maîtriser ces risques.
Claire, simple et logique, la méthodologie paraît implacable. Mais pour les collaborateurs, les enjeux de la démarche étaient doubles :
– parvenir à une connaissance approfondie des structures avec lesquelles la collectivité travaillait, notamment du point de vue financier,
– faire partager aux acteurs culturels une vision commune du service public et traduire cette vision par des objectifs, des indicateurs de suivi et de performance.
De la technocratie dans la culture, en somme…

Bien sûr, si les acteurs culturels ont perçu tout cela comme un changement de paradigme, le changement de paradigme s’est aussi opéré en interne.
Le changement ne se décrète pas, il se vit.
« Nous n’arrivons pas à changer les choses suivant notre désir, mais peu à peu notre désir change. » Marcel Proust dans Albertine disparue
Pour les collaborateurs, la mise en œuvre d’un tel plan d’actions est souvent un chantier complexe, ambitieux et anxiogène car il vient modifier les habitudes de travail. Il y a des objectifs à atteindre, des échéances pour y arriver, des indicateurs pour marquer les avancées et un reporting à organiser. Il faut faire évoluer sa posture vis-à-vis des partenaires, aborder les questions qui fâchent – comme le montant des subventions, mettre en place des stratégies de négociation et beaucoup d’autres choses.
Dans ce contexte, le rôle du manager est d’abord de conduire le changement avec toute la dimension de pilotage que cela implique. Car le manager doit lui aussi rendre des comptes à sa hiérarchie et, dans le cas d’une collectivité publique, aux élus. Il est lui-même évalué sur l’avancée du projet.

Mais conduire ne suffit pas : il faut aussi accompagner le changement. Cela est connu et reconnu, le changement fait peur. Lorsqu’il arrive avec ses gros sabots, le changement nous fait tous passer par les mêmes stades :
– Le déni, qui n’est rien d’autre qu’un réflexe de défense,
– La résistance, qui est déjà un stade d’acceptation de l’existence du changement, mais dans lequel on tente d’en limiter les conséquences,
– L’exploration, qui est la phase la plus constructive intellectuellement puisqu’on y analyse les pistes d’évolution et de progrès,
– La mobilisation, enfin, qui suppose que les avantages liés au changement soient acceptés et suffisamment motivants pour embarquer les équipes.
Pour le manager, cela implique un important travail de pédagogie, de l’exemplarité, de la démonstration, du conseil, la mise en place de formations pour les collaborateurs et un savant mélange entre autorité, écoute et dialogue. Et il faut un certain courage managérial pour embrasser l’ensemble de ces dimensions, puisque l’on doit non seulement pouvoir parler objectivement des difficultés opérationnelles et des contraintes du terrain, mais aussi les traduire pour amender et adapter le calendrier, tout en maintenant le cap. C’est le prix de l’adhésion des équipes.
Et notre voleur de tableaux ? L’histoire retiendra qu’il fut retrouvé, jugé et condamné!