Comment expliquer le succès au box-office d’un film sur des hommes en pleine crise de la quarantaine, écornés par la vie, pas spécialement beaux – ni en dehors, ni en dedans, et qui décident un jour de se lancer dans la natation synchronisée ?
Car « Le Grand Bain » de Gilles Lellouche est indéniablement l’un des films les plus jouissifs de ces dernières années.
Le sociologue Ronan Chastellier, auteur de « Tous en slip » (Editions Du Moment), relie ce succès au retour vers un désir d’authenticité. Instagram véhicule en masse du galbe parfait mais, nous dit-il, le public tend à réagir par une envie de réel – quitte à ce que le réel soit un peu écorché.
En effet, il est beaucoup plus facile de s’identifier à cette bande de copains. Certes, ce sont des perdants. Lovés dans leur loose comme nichés dans un duvet, ils sont franchement pathétiques. Mais aussi touchants. Puis merveilleux, lorsque la victoire arrive, enfin, après les nombreux échecs.

La morale de l’histoire est simple et s’applique à la sphère privée comme au travail : on peut rebondir après une défaite et apprendre de ses échecs. C’est d’ailleurs le sens de récents modèles de management, au cœur desquels l’échec a une place de choix. Voyons cela de plus près.
Echec ou erreur ?
Le précédent post du Billet du Manager traitait du droit à l’erreur. Alors bis repetita ? Eh bien après quelques lectures supplémentaires et à y réfléchir de plus près, il y a une distinction importante entre l’erreur et l’échec.
Comme l’explique Francis Boyer, auteur du blog innovationmanageriale.com, l’erreur intervient lorsqu’on se trompe par rapport à un référentiel précis, un cadre d’actions. C’est par exemple le cas lorsque l’on n’a pas correctement suivi les instructions d’une procédure.
L’échec apparaît, lui, lorsque l’on n’a pas atteint son objectif.
« On échoue lorsqu’on n’est pas parvenu à respecter son engagement, un objectif, une ambition », Francis Boyer
Il peut alors s’agir de son propre échec, de celui de son équipe, de celui de son n+1 ou encore d’un échec plus large touchant l’entreprise ou l’organisation elle-même. Et dans les collectivités territoriales, il faut en plus savoir appréhender l’échec éventuel de ses élus, l’exemple le plus courant étant la défaite électorale.
Quoiqu’il en soit, il est possible d’en tirer avantage.
L’échec : un « plus » pour l’organisation ?
John Danner et Mark Coopersmith, les auteurs de « The other F word », détaillent en quoi l’échec serait carrément un atout pour les organisations.
Ce qu’ils nous disent, c’est que grâce à l’analyse de ses échecs, une entreprise peut combler le déficit de ses propres connaissances et améliorer, ce faisant, son prochain cycle décisionnel. Cette analyse systématique permettrait in fine de ne pas rester prisonnier de son propre système de croyance.
« On apprend peu par la victoire, mais beaucoup par l’échec. » Proverbe japonais
A titre d’exemple, la culture entrepreneuriale de l’échec fait florès dans la Silicon Valley.
Là-bas, les start upers s’adonnent à des « Fuck up nights » qui consistent pour les entrepreneurs à se raconter leurs échecs les plus cuisants. Cela fonctionne parce que le monde des start ups considère souvent l’échec comme une étape normale du développement. En effet, rare sont les idées qui fonctionnent du premier coup. Lorsqu’une start up se rend compte que le projet initial mène au mur, elle « pivote ». Le « pivot » peut se résumer par une manœuvre tactique se traduisant par un changement de direction. Son objectif est d’adapter le produit à la demande des clients. Cette capacité d’adaptation est d’autant plus ancrée dans le monde des start ups que 9 sur 10 d’entre elles pivotent par rapport au business model de départ. Pis : une fois sur deux, le pivot est total.

Au-delà du monde des start ups, c’est également sur le nouveau continent que l’ on a vu se développer des événements assez proches dans la philosophie. Ce sont les fameux « FailCons » dédiées aux échecs commerciaux, politiques, sportifs et autres. La France s’y est aussi essayée, d’ailleurs.
Mais comme on l’évoquait dans le précédent post concernant le droit à l’erreur, il y a une dimension culturelle qui rend l’échec particulièrement honteux pour les entreprises françaises. Alors qu’aux Etats-Unis comme au Royaume-Uni, il est souvent le ciment d’un story-telling de choc. A ce sujet, on cite souvent Steve Jobs, fondateur d’Apple, qui s’est fait licencier de sa propre société et qui a fait de cet épisode sa légende.
Pourtant, même chez nous, il existe une prise de conscience managériale, en témoigne des lectures comme le dossier « un jour, je me suis planté » de la Lettre du cadre. Mieux : pour des entreprises françaises comme Blablacar, « reconnaître l’échec comme une étape du processus d’apprentissage et prendre le risque d’échouer sont des démarches nécessaires pour innover avec succès » (blog.blablacar.fr).

Alors, l’innovation managériale est-elle en route ?
La prise en compte managériale de l’échec : le fail management
Depuis quelques années, les recherches sur l’échec entreprenarial a donné lieu à un mode de management per se : le « fail management ». Cette approche managériale offre des clés intéressantes de prévention et de gestion de l’échec.
Il en existe plusieurs mais Danner et Coopersmith (les auteurs de « The other F word ») proposent une méthodologie en 7 étapes, assez simple mais efficace :
1. Faire preuve d’humilité face à l’échec : tout le monde fait l’expérience de l’échec à un moment de sa vie, même notre fameux Steve Jobs.
2. S’entraîner à échouer : puisqu’il est inévitable, il faut se préparer à l’échec. Cela passe par un système d’alertes, par exemple sur les erreurs de recrutements, ce qui implique de mettre en place la remontée d’informations, notamment par la DRH.
3. Identifier les symptômes de l’échec grâce à l’analyse d’indicateurs idoines.
4. Réagir : face au constat d’échec se pose la question du « pivot », ce moment où l’entrepreneur doit décider de « vivoter » ou de « pivoter » en changeant de business model. Cela nécessite une certaine flexibilité, ce qui est particulièrement délicat dans les organisations publiques, par nature bureaucratiques.
5. Réfléchir aux véritables causes : dans cette étape, il s’agit de chercher l’origine de l’échec. La gestion de l’humain est ici essentielle et les auteurs conseillent aux dirigeants eux-mêmes d’analyser leur attitude par rapport à l’échec.
6. Rebondir avec confiance : une fois l’échec identifié, traité et analysé, il faut une bonne dose de courage pour se relancer. Ce qui aide, nous disent les auteurs, c’est de cultiver la capacité collective à regarder l’avenir et à ne pas rester figé dans son système de croyance ni dans le passé. Les valeurs portées par l’organisation peuvent d’ailleurs en être le levier.
7. Ne jamais oublier : ne pas rester figé dans le passé, certes, mais sans en faire table rase. Car il sera toujours utile managérialement parlant de valoriser ces épisodes qui ont pu être dépassés collectivement. C’est la part de story telling de l’échec.
Ce genre de méthodologie est pertinent pour tout type d’organisation. Mais ne nous méprenons pas : le fail management ne consiste pas à valoriser l’échec. En réalité, il s’agit plutôt de l’objectiver en le reconnaissant comme une étape nécessaire et inévitable dans la vie de l’organisation.

Comme le conseillent Danner et Coopersmith, le caractère inéluctable de l’échec invite donc à travailler sur sa propre relation à la défaite. Ce qui, en tant que manager, n’est pas franchement évident.
Plus fort dans la défaite.
« Ever tried. Ever Failed. No Matter. Try again. Fail again. Fail better. », Samuel Beckett, Worstward Ho
C’est tout un état d’esprit que d’appréhender positivement l’échec. Echouer n’est pas chose facile, surtout lorsqu’il s’agit de ses propres défaites. Ainsi, 57% des managers interrogés dans un sondage de l’Association progrès du management témoignent que « rebondir après un échec professionnel est particulièrement difficile ». En général, les réactions sont souvent proches du déni ou de l’abattement. Le renoncement n’est jamais loin, ni la tentation de rejeter la faute sur les autres.
L’intérêt de l’échec, en management comme dans sa vie personnelle, c’est de savoir ce qu’on en fait. C’est ce que raconte Losers, série documentaire réalisée par Mickey Duzyj et produite par Netflix. Avec huit épisodes de trente minutes, Losers raconte la beauté de la défaite à travers le portrait de sportifs de haut niveau.

L’un des meilleurs épisodes est sans doute celui qui raconte l’histoire de la patineuse artistique Surya Bonaly. Aujourd’hui entraîneuse aux Etats-Unis, l’athlète se remémore l’incroyable sentiment d’injustice qu’elle a ressenti sur les patinoires olympiques des années 90. Noire, elle était une figure à part dans le monde du patinage à l’époque. « Exotique, pas assez gracieuse, trop athlétique… » Surya Bonaly n’aura jamais réussi à assoir sa légitimité face aux conservatismes des juges. Jamais elle ne réussira à gagner sa médaille d’or, même en ce jour des mondiaux de 1994 à Chiba, au Japon. Elle réalise un programme parfait, que ce soit techniquement ou artistiquement, avec notamment un triple lutz impeccable. Mais les juges lui préfèreront une outsider inconnue du grand public, la japonaise Yuka Sato. Ulcérée par l’injustice patente dont elle se sent victime, Surya Bonaly refuse de porter sa médaille d’argent.
Mais en 1998, l’athlète revient sur le devant de la scène aux Jeux olympiques de Nagano, à nouveau au Japon. Elle pense pouvoir prendre sa revanche et atteindre le haut du podium. Hélas, le sort s’acharne : lorsque les Jeux commencent, elle n’est toujours pas remise d’une blessure au talon d’Achille. A ce moment, elle sait qu’elle ne pourra pas réaliser de triples sauts. Non seulement elle doit s’assoir sur la médaille d’or tant attendue. Pire : ce sont ses derniers Jeux, car la jeune femme est déjà une ancienne sur le circuit.
Qu’à cela ne tienne ! Elle réalisera pour la gloire une figure complètement interdite : un salto arrière.
Le public l’ovationne au grand damne des juges qui, eux, la sanctionnent en l’envoyant au bas du classement. Mais au final, c’est ce salto arrière qui est rentré dans l’histoire du patinage artistique et du sport olympique. Un joli pied de nez aux juges qui ne lui ont jamais permis de savoir la victoire espérée, et surtout une capacité à faire de la défaite quelque chose de magnifique.
Alors que retenir ? Eh bien l’inspiration managériale est presque triviale : au-delà de la défaite, il y a la possibilité de la résilience et l’opportunité du rebond.
Vers la fin du leader infaillible
« Il n’y a pas de réussite facile ni d’échecs définitifs » Marcel Proust, A l’ombre des jeunes filles en fleur
Malgré tout, demander à un manager d’embrasser la défaite reste toutefois quelque chose d’encore assez contre-nature, quand on y pense. Pendant des années, on a plutôt mis en avant le caractère infaillible des leaders, jusqu’à en faire un mythe.
Or, sans un leadership prêt à accepter l’échec comme autre chose qu’un drame inacceptable, difficile de mettre en place quelque fail management que ce soit.
Pourtant, une évolution semble là aussi à l’œuvre.
S’appuyant sur des chercheurs comme Bradley P Owens, professeur associé en éthique commerciale à l’université Brigham Young, la journaliste Sue Shellenbarger du Wall Street Journal explique comment certains employeurs commencent à réaliser en quoi l’humilité est une qualité fondamentale du leadership.
Bien sûr, en période de crise, par exemple, un leadership plus autoritaire peut être salvateur. Mais sur le long terme, Sue Shellenbarger rapporte qu’il y aurait une corrélation entre l’humilité des dirigeants d’une entreprise et la qualité du travail. Logique : cette attitude favorise la collaboration et le partage de la prise de décision, ce qui conduit au final à une plus grande efficacité, innovation et rentabilité.

C’est la raison pour laquelle de plus en plus d’entreprises proposant des outils de gestion de talents et compétences se prêtent dorénavant au jeu. Elles mettent au service des recruteurs des solutions permettant d’identifier le niveau d’humilité des candidats aux postes les plus « hauts » et, ainsi, leur aptitude à porter un regard différent sur l’échec – qu’il soit individuel ou collectif.
Tout laisse donc à penser qu’aujourd’hui, l’innovation managériale gagne là aussi du terrain. Ce faisant, elle contribue à un management de plus en plus conscient que l’échec n’est pas un tabou mais une opportunité. Affaire à suivre…
Un article proposé par le Billet du Manager, en partenariat avec le Lab’AATF


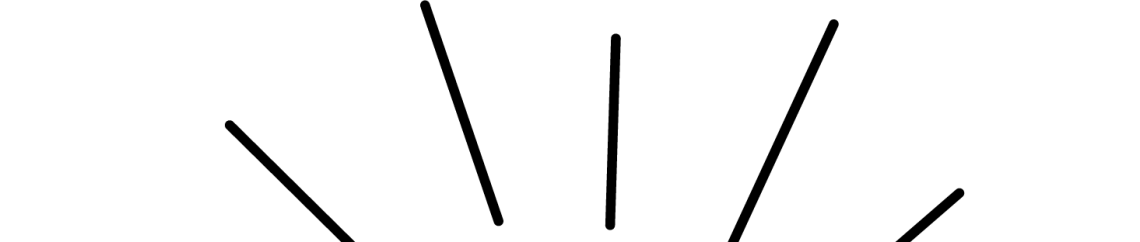


1 commentaire