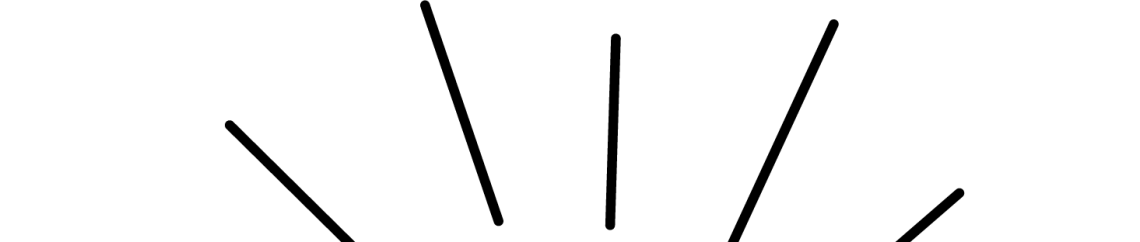Les vacances sont terminées. Compte tenu de la crise sanitaire, il y a de grandes chances que cette année, vous les aurez passées en France. Et si vous avez des enfants, ou si vous avez gardé cette part d’enfance en vous, vous avez peut-être profité de l’un des 300 parcs d’attractions qui maillent le territoire. D’autant plus qu’il y en a pour tous les goûts : parcs à sensations, parcs thématiques, parcs animaliers…
Première destination touristique privée en Europe (avant la crise sanitaire), Disneyland Paris est sans conteste l’un des parcs les plus connus. L’un de ses manèges les plus populaires est inspiré de la série de films « Pirate des Caraïbes ».
Mais saviez-vous qu’en fait, les aventures du Capitaine Jack Sparrow, personnage principal interprété par Johnny Depp, sont inspirées… d’un manège à sensations ? Il s’agit en l’occurrence d’une attraction du même nom ouverte en 1967 dans le tout premier parc Disneyland, en Californie.
C’est aussi dans les années 60 qu’un autre film de corsaires et pirates est sorti à l’écran : « Les révoltés du Bounty ». Réalisé par Lewis Milestone en 1962 et avec Marlon Brondo dans le rôle principal, cette pépite cinématographique s’inspire de l’histoire vraie d’une mutinerie menée par le Lieutenant Fletcher Christian contre le Capitaine William Bligh.

L’histoire du Bounty a été une source d’inspiration pour de nombreux poètes, écrivains et cinéastes (une version de 1982 avec Mel Gibson et Anthony Hopkins vaut aussi le détour). Bien souvent, ces productions interprètent cet évènement sous l’angle romantique d’une victoire de la liberté contre l’autoritarisme incarné par le Capitaine Bligh. Pourtant, la réalité historique ne semble pas si manichéenne : les témoignages d’époque et les recherches entreprises, depuis, par les historiens montrent que le Capitaine Bligh était certes détesté par certains, mais apprécié par d’autres.
L’historien britannique spécialisé dans l’histoire maritime, Richard Hough, est de ceux-là. Pour lui, le Capitaine Bligh était un homme pleinement dévoué à sa mission, particulièrement doué pour traverser les tempêtes. « J’irais contre vents et marées avec lui », écrit-il dans son étude sur l’histoire du Bounty.
Alors qu’est-ce qui explique qu’un même Capitaine puisse inspirer les uns, conduire les autres à la défiance, puis carrément à la rébellion ? Autrement dit : quel est le portrait du capitaine qui donne envie de s’engager ?
… Ou pas.
« Nous n’avons pas les mêmes valeurs »
Dans l’un des derniers billets du manager, on montrait en effet les apports de la psychologie sociale sur la compréhension des motivations (et de l’appréciation de l’autre). Elles dépendaient du propre système de valeurs de chacun. C’est en particulier l’apport d’un Shalom H. Schwartz et de son diagramme des valeurs :

Selon Schwartz, nous aurions tous ces valeurs, mais avec une hiérarchie différente. Et c’est précisément cette différence qui peut créer une première source de dissensions entre collègues, par exemple… Ou avec son manager !
Cela dit, Schwartz nous dit aussi que des personnes ayant la même hiérarchie de valeurs peuvent quand même être confrontées à des dissensions. Par exemple, si le manager et le collaborateur ont tous deux placé la valeur « autonomie » très haut, l’équation peut alors être la suivante :
- Le manager a besoin d’informations sur le travail du collaborateur pour se sentir autonome,
- Mais le collaborateur ne se sent, lui, autonome que s’il est soumis à un reporting léger,
- Par conséquent, chacun recherche le confort dans une situation qui rend paradoxalement l’autre inconfortable.
Pour résoudre l’équation, il faut donc pouvoir en échanger pour trouver un compromis acceptable par chacun.
Les apports Schwartz vont encore plus loin dans la subtilité : chacun projette sur les autres ses propres besoins et son propre système de valeurs… D’où l’intérêt de faire l’effort de dépasser ce biais pour décortiquer ce que cela dit de soi, et de le partager sereinement.
Dans le cas du Bounty, par exemple, le caractère tyrannique du Capitaine Bligh a été mis en avant par certains auteurs pour expliquer la mécanique sociale qui a conduit à la mutinerie. Dans la « vraie vie », la sévérité du Capitaine était bien connue de tous. Il n’est toutefois pas sûr que cette sévérité ait été aussi effroyable que celle représentée dans la fiction. D’autant plus que le caractère austère du Capitaine Bligh était apprécié par certains.
Alors au fond, est-ce grave, la sévérité ?
Eh bien comme une bonne choucroute, tout est question de proportion : trop de chou et on étouffe, pas assez et il manque quelque chose.
« C’est moi le chef ! »
Faut-il réhabiliter l’autorité ?
C’est une vraie question, à l’heure où le collaboratif et le participatif font le lit des discours autour du management moderne. Au point où l’usage de certains mots comme « bienveillance » frôle l’overdose. La faute à ceux qui l’utilisent à tort et à travers ou comme un étendard sans armée.
Clarifions le malentendu.
La bienveillance, c’est avoir une disposition favorable à autrui – vouloir du bien à l’autre a priori. Il est donc logique que le manager qui adopte cette posture tend à favoriser l’engagement. D’ailleurs, dans un article du Harvard Business Review, Gaël Chatelain-Berry explique bien pourquoi ça fonctionne :
- Le management bienveillant fait baisser l’absentéisme,
- Il accroît la productivité,
- Il contribue à réduire le turnover,
- Il améliore la marque employeur,
- Il facilite la créativité des collaborateurs.
Et comme on l’a déjà écrit sur le billetdumanager.com, la recherche du bien-être au travail peut d’ailleurs être considérée comme une fin en soi. Je connais des managers qui sont même prêts à une perte de productivité des équipes si cette production se fait au prix de conditions de travail non souhaitables.
Mais un manager bienveillant peut/doit aussi manier l’art de l’autorité. D’autant plus qu’en réalité, l’autorité dite « naturelle » ou le « faire autorité » renvoie la plupart du temps plutôt à de l’exemplarité, à des valeurs incarnées ou à de la compétence reconnue. Il ne s’agit pas d’une simple capacité à trancher ou à organiser le travail d’une équipe.
Prenons un exemple très concret que beaucoup de managers ont rencontré un jour : l’incompétence professionnelle et/ou sociale.
Des chercheurs ont analysé ce qui se passait dans des équipes confrontées à la présence d’un « passager clandestin », pour reprendre un terme consacré par l’économie comportementale. Vous savez, c’est cette personne qui n’est pas à la bonne place et qui, souvent, perturbe l’équilibre du groupe par son attitude agressive, impertinente et impolie. Les raisons qui ont conduit à cette situation peuvent être nombreuses, et n’oublions pas que la plupart du temps, il s’agit en réalité d’une personne en difficulté, voire en souffrance. Son attitude offensive est alors un moyen de défense (conscientisé ou pas, d’ailleurs).
En fait, le passager clandestin est tout autant une victime de la situation que le reste de l’équipe qui ne comprend pas que l’on ne sanctionne pas le non-respect des règles du jeu… Jusqu’à potentiellement décider de ne plus les respecter lui-même (c’est d’autant plus vrai si, dans une équipe, l’absence de sanction des manquements va de pair avec l’absence de valorisation des comportements positifs).
En conclusion, personne n’est foncièrement heureux de cette situation.
Et le manager ? Eh bien des chercheurs de l’Université de Bath, en Angleterre, ont identifié que ces comportements s’exerçaient en particulier à son encontre. Plus le manager est bienveillant, plus le comportement asocial est important.
Leur interprétation : le manager bienveillant est souvent la personne idéale contre laquelle l’individu peut agir pour compenser son insécurité et sa frustration. Le paradoxe étant que le manager bienveillant met généralement en place des actions altruistes à l’égard du passager clandestin : des gestes pour l’intégrer au groupe, des propositions de formations pour développer ses compétences, etc.
Mais justement, les chercheurs de Bath ont montré que toutes ces actions altruistes peuvent avoir tendance à être perçues par le passager clandestin comme des signes insidieux de la part du manager bienveillant : le manager bienveillant souhaiterait montrer sa supériorité en termes de comportement et de compétence.
C’est pourquoi faire preuve d’autorité peut être salutaire, nous disent ces chercheurs.
Cela vaut pour des cas dysfonctionnels comme dans notre exemple, mais sans aller jusque-là, l’autorité peut aussi s’exercer dans des environnements collaboratifs simplement composés de « personnalités difficiles », comme on aime à les appeler.
C’est, par exemple, le cas du collaborateur un peu rebelle : dans un univers plutôt policé comme celui de nos organisations, la « rebellitude » a quelque chose d’un peu décontenançant, y compris pour le manager. D’ailleurs, les psychologues expliquent cela par le fait que le collaborateur indélicat peut malgré lui faire fonction de miroir pour le manager : il lui renvoie des comportements qu’il n’aime pas chez lui-même, qui lui font honte ou qu’il cherche à taire.
L’exercice d’autorité n’est toutefois pas facile : parfois, le manager ne se sent pas légitime. C’est le cas lorsque l’autorité est confondue avec l’autoritarisme.
Mais dépasser cette crainte de basculer dans l’autoritarisme est essentiel : le manager est responsable du climat et de l’efficacité de son service. Lorsque les comportements déviants ne sont pas canalisés, le manager risque de contribuer à installer un cycle de désengagement :
- Il y a d’abord une phase d’inaction : lorsque la situation se dégrade, les collègues ont tendance à ne pas réguler la situation entre eux et à plutôt attendre du manager qu’il agisse,
- Ensuite vient une phase d’acceptation : si aucune régulation n’a été faite, collectivement ou via le manager, les collaborateurs finissent par accepter et incorporer les comportements déviants,
- Enfin survient la phase de désengagement. Compte tenu de la dégradation du collectif de travail, l’engagement des collaborateurs est compromis, ainsi que celui du manager lui-même : remise en question de sa propre légitimité par le manager, mise en place de stratégies d’évitement comme l’organisation de réunions pendant un jour d’absence du collaborateur problématique (auquel on va d’ailleurs confier des dossiers à réaliser en solitaire pour éviter de parasiter le collectif)… Jusqu’à basculer, ce faisant, dans un risque d’accusation de harcèlement.
C’est pourquoi les attitudes passives, attentistes voire démissionnaires sont à proscrire, nous disent chercheurs comme praticiens : le manager bienveillant doit aussi avoir le courage de faire preuve de fermeté et de poser le cadre régissant la vie de l’équipe.
Mais à chacun de trouver son rythme, bien sûr. Un manager bienveillant voudra peut-être se laisser un délai pour épuiser différentes solutions avant de sévir. 😊
« C’est un mégalo… »
Pas facile pour autant de bien doser le niveau d’autorité ! D’autant plus que notre société et nos organisations sont pleines de paradoxes à cet égard.
A l’heure où la Lettre du cadre territorial, en partenariat avec le cabinet de conseil Cap Nova, prépare la très attendue enquête sur les grandes tendances des pratiques managériales, les leviers managériaux les plus cités ces dernières années tournaient autour des postures de « délégation et responsabilisation », « écoute » et « confiance ». Mais à l’autre bout du spectre, nos organisations sont encore largement matinées d’une culture bureaucratique, verticale, et d’un management axé sur la performance…
A l’image de notre société, explique la Psychiatre française Marie-France Hirigoyen.
Pour celle qui a contribué à l’introduction de la notion de harcèlement moral dans le Code du travail, l’exigence de performance est désormais partout : dans la vie professionnelle comme dans la vie privée. Les réseaux sociaux le montrent bien : pour beaucoup, ils sont devenus essentiels pour exister socialement (cf ma nouvelle photo de profil sur LinkedIn ? ^^ ). Compte tenu de ces circonstances, elle ne s’étonne donc pas que notre société soit devenue le ferment idéal pour un certain nombre de troubles du registre narcissique.
Cela renvoie par exemple au vaste sujet du besoin d’amour/reconnaissance/validation du manager qui refuse d’exercer la partie « autorité » du management – un peu comme s’il chassait les likes sans se préoccuper de savoir si cela fait avancer le collectif.
Il y a aussi le cas des « Narcisse pathologiques mégalomanes », explique Marie-France Hirigoyen.
En effet, certaines organisations légitimisent dans leur culture organisationnelle un style de management qui fait le nid de ces individus, prévient-elle. Elles le font en mettant les uns et les autres en concurrence et en valorisant les fortes personnalités. Or, les individus narcissiques ont un énorme besoin de reconnaissance. Ils sont doués pour se mettre en avant.
Or contrairement aux apparences, certains Narcisses sont en réalité des individus fragiles parce que leur forte estime d’eux-mêmes est instable ou artificiellement gonflée. Dans de tels cas, ils auront tendance à développer des stratégies agressives envers les autres – souvent de façon inconsciente. Cela pourrait d’ailleurs être le cas de notre passager clandestin, décrit plus haut.
Eh oui, la vie de bureau, c’est parfois du Marivaux : « j’ai besoin que tu m’aimes MAIS j’ai peur que tu ne m’aimes pas – ce que je ne maîtrise pas. DONC je te rejette avant que tu ne me rejettes, ce qui me permets de garder le contrôle. »
« Mais on vous apprend quoi à l’école ?! »
Sans aller jusqu’à ces cas extrêmes, les travers de nos systèmes de pensée managériale sont largement documentés. Des chercheurs comme les sociologues Michel Crozier ou encore Philippe d’Iribarne ont montré en quoi les pratiques managériales restent marquées par des conceptions traditionnelles, hiérarchiques et centralisées, empruntes d’une conception monarchique de l’exercice du pouvoir – avec des conséquences néfastes pour les organisations, comme le montre par ailleurs un François Dupuy, par exemple.
Henry Mintzberg, lui, remet carrément en question la façon dont le management est enseigné, notamment aux futurs top managers. En prenant appui sur ce qui est pratiqué dans des grandes universités comme Harvard ou Stanford, il explique en quoi l’enseignement du management – et en particulier des MBA – contribue à fabriquer des managers gestionnaires. Pour lui, ceux-ci sont biberonnés par des approches analytiques et quantitatives depuis la fin des années 50.
Cela dit, les recherches de Mintzberg pourraient utilement être mises en perspectives avec celles, plus récentes, de Hans Schlierer et Damien Richard, respectivement Professeur en négociation internationale à l’EM Lyon et Enseignant chercheur en management à l’INSEEC School of Business & Economics. En utilisant l’outil web Ethimak et le modèle des valeurs universelles de Schwartz, qu’on évoquait plus haut, ils ont conclu qu’on ne pouvait pas généraliser la critique de Mintzberg à toutes les écoles de management. En réalité, les valeurs qui guident les étudiants diffèrent d’une école à une autre.
Et chose intéressante, il semblerait que la valeur de pouvoir soit beaucoup moins présente dans leurs têtes que celle de la sécurité. Pour ces chercheurs, cela s’explique d’abord par l’influence des cultures des grandes entreprises par lesquelles passent les étudiants : celles-ci font la part belle aux procédures et aux enjeux de sécurité (les procédures y reflètent les besoins de sécurisation de l’information et de sécurisation juridique). Cela s’explique aussi par l’inquiétude des étudiants qui sont de moins en moins sécurisés dans leur parcours.
Quoiqu’il en soit, il n’en demeure pas moins que les formations au management – en formation initiale comme en formation continue/entre pairs – restent un levier essentiel pour :
- Identifier quelles sont les postures qui nuisent à l’engagement des collaborateurs,
- Identifier quelles sont celles à privilégier.
A titre d’exemple, les coachings collectifs d’équipes de CODIR ont le vent en poupe, car ils permettent de travailler aussi bien sur les postures que sur le rôle du collectif managérial (pour en savoir plus : Bienvenus à bord ! Faire équipe et collectifs de managers.).
« Je vous fais confiance. »
En matière de postures, la question de l’autonomie est centrale, en particulier dans un environnement aussi complexe que celui dans lequel nous vivons.
« L’univers tout entier est un cocktail d’ordre, de désordre et d’organisation. Nous sommes dans un univers d’où l’on ne peut écarter l’aléa, l’incertain, le désordre. Nous devons vivre et traiter avec le désordre. » Edgar Morin, Introduction à la pensée complexe
On l’a clairement vu avec la crise mais ça l’était déjà avant : les modèles organisationnels qui permettent de faire face aux plus hauts degrés de complexité sont ceux qui accordent le plus d’autonomie aux entités organisationnelles. Or, comme on essaie régulièrement de le montrer sur lebilletdumanager.com, l’autonomie et la confiance sont des éléments clés pour entraîner l’engagement des collaborateurs. Pour autant, en tant que manager, le confinement a également montré un désir de ne pas perdre totalement le contrôle quand bien même les risques de déresponsabilisation des modèles centralisateurs ont largement été documentés.
Alors comment concilier au mieux ces deux approches ?
Spotify semble être un bon exemple. Son modèle organisationnel affirme très justement qu’autonomie et contrôle sont deux éléments tout à fait conciliables. Comme Laurel et Hardy, Rachel et Ross, Han Solo et Chewbacca, l’un ne va pas sans l’autre.

Spotify structure son organisation sous forme de squads qui sont des équipes pluridisciplinaires auxquelles des missions de long terme sont fixées. Chaque équipe est autonome : elle peut s’organiser comme elle le souhaite, du moment que la mission confiée est accomplie. Elle est aussi responsable de ses réalisations. Le contrôle et la coordination s’opèrent sur l’alignement des squads avec la stratégie globale de l’entreprise et, d’un point de vue plus opérationnel, avec les objectifs de court-terme qui leur sont fixés. Et il semblerait que ça marche !
Qu’est-ce que cela nous dit ?
Eh bien qu’il est a priori possible d’augmenter le niveau d’autonomie des équipes non pas en diminuant le niveau de contrôle du manager, mais plutôt en se reposant sur de nouvelles modalités de contrôle.
Docteur en sciences de gestion et professeur à l’IAE de Paris, Eric Delavallée propose ainsi une combinaison fort intéressante :
- Le contrôle par les pairs, qui permet une régulation autonome et un ajustement mutuel,
- Le contrôle par les résultats, qui s’articule autour d’une déclinaison fine et précise des objectifs, ainsi que de cycles de pilotage courts,
- La culture d’entreprise qui, si elle est forte et partagée, favorise un alignement des collaborateurs sur la stratégie de l’organisation,
- Les « métarègles », qui sont les principes d’organisation, de gestion et de fonctionnement de chaque entité organisationnelle.
Ces modalités, nous dit-il, ne sont pas exclusives les unes des autres mais complémentaires : comme les L5 ou les Backstreet Boys, elles se renforcent les unes les autres.
« Je vous ai compris ! »
Dans un rapport de 2016 établi à partir d’une étude réalisée auprès de 15 pays, le Forum Economique Mondial a identifié les 10 soft skills (ou « compétences douces ») déterminantes du management de demain :
1 – Résolution de problèmes complexes
2 – Pensée critique
3 – Créativité
4 – Gestion des personnes
5 – Coordination avec les autres
6 – Intelligence émotionnelle
7 – Jugement et prise de décision
8 – Souci du service client
9 – Négociation
10 – Flexibilité cognitive
Parmi ces « compétences douces », l’intelligence émotionnelle est l’une des plus recherchées par les collaborateurs vis-à-vis de leurs managers.
En effet, l’intelligence émotionnelle se définit comme la capacité à comprendre les émotions des autres, à collaborer avec eux et à se montrer social. Elle permet aux managers de penser leurs ressentis, de les relativiser et de les accorder avec le ressenti des autres. Si bien que l’intelligence émotionnelle est indéniablement un vecteur de bien-être dans un collectif de travail. Elle est à l’opposé d’une sorte de macro-management qui considèrerait que la règle et le process priment sur les personnalités, les aspirations individuelles, etc., et que tout le monde doit rentrer dans ce moule.
Avec l’intelligence émotionnelle, on passe d’une logique où les différences sont des déviances à une logique où elles sont plutôt des richesses complémentaires qui peuvent évoluer dans un cadre défini – pourquoi pas collectivement.
Mais attention à ne pas faire l’impasse sur l’intelligence cognitive, nous dit le psychologue du travail Emeric Kublak.
« L’intelligence est une capacité mentale très générale qui, entre autres, implique la capacité de raisonner, de planifier, de résoudre des problèmes, de penser de façon abstraite, de comprendre des idées complexes, d’apprendre rapidement et d’apprendre de l’expérience. Ce n’est pas simplement un apprentissage des livres, une compétence académique étroite ou une mesure de test d’intelligence. Plutôt, elle reflète une capacité plus large et plus profonde de comprendre notre environnement, le « saisir », « donner du sens » aux choses ou « déterminer » que faire. » Emeric Kublak, Harvard Review Business
Prenant appui sur plusieurs recherches, il explique en quoi l’une et l’autre des formes d’intelligence ne s’excluent pas. En effet, l’efficacité collective n’est pas uniquement corrélée à l’intelligence émotionnelle. L’intelligence cognitive des membres de l’équipe, et au premier chef du manager, a un impact direct sur la réussite collective. Cela serait en particulier vrai lorsque l’équipe est confrontée à un environnement nouveau : elle aurait plus de facilité à partager des informations et à apprendre rapidement.
« Beaucoup encore il te reste à apprendre », Maître Yoda (Star Wars II).
Dans la mythologie grecque, Mentor est l’ami d’Ulysse et le précepteur de son fils, Télémaque. C’est ce qui a donné naissance au mot « mentorat ». Ce dernier désigne ainsi une relation interpersonnelle de soutien, d’échanges et d’apprentissage, dans laquelle une personne d’expérience investit sa sagesse acquise et son expertise afin de favoriser le développement d’une autre personne qui a des compétences à acquérir et des objectifs professionnels à atteindre.
Comme l’indique à juste titre Marlène Moreira du site www.welcometothejungle.com, le mentorat ou mentoring peut prendre de nombreuses formes et n’est pas réservé aux plus jeunes. Mais quelle que soit la forme qu’il prend, un manager qui adopte une posture de mentor tend à favoriser l’engagement de ses collaborateurs :
- Il aide son collaborateur à se fixer des objectifs atteignables et mesurables,
- Il peut le challenger lorsque l’ennui s’installe,
- Il aide à ne pas reproduire les mêmes erreurs que celles qu’il a pu commettre,
- Il fait profiter ses collaborateurs de son réseau.
« Ô Capitaine ! Mon Capitaine ! »
En France, le poème « O Captain! My Captain! » de Walt Whitman est devenu célèbre auprès du grand public grâce au film réalisé par Peter Weir en 1989 : « Le Cercle des Poètes Disparus ».
Ecrit en hommage au président des États-Unis Abraham Lincoln, assassiné le 14 avril 1865, il décrit l’arrivée au port d’un navire et de son capitaine, le calme après la tempête.
« Ô Capitaine ! mon Capitaine ! fini notre effrayant voyage,
Le bateau a tous écueils franchis, le prix que nous quêtions est gagné,
Proche est le port, j’entends les cloches, tout le monde qui exulte […]. »
Walt Whitman
Ce sont sans doute des vers qui auraient pu inspirer bon nombre de managers en mai dernier, lorsque le confinement a pris fin. Aujourd’hui, la crise à proprement parler n’est pas complètement achevée, bien sûr. Et à l’heure d’un perceptible rebond, certains prônent même le recours aux « managers de transition ».
Pour faire simple, il s’agit pour un employeur de faire appel à un manager externe et expérimenté sur un temps court, afin de diriger une équipe sur un projet bien défini. La mobilisation se fait en général sur des situations que l’on peut comparer à un contexte de crise, comme une fusion/acquisition. Mais cela peut aussi se faire pour une campagne de recrutements massifs. Et dans le contexte actuel, certaines entreprises envisagent de recourir au management de transition pour régler les problèmes de trésorerie que beaucoup d’entre elles connaissent à l’heure du post-confinement.
Avec l’œil vers les impacts de plus long terme de la crise, certains employeurs y songeraient pour accompagner les transformations managériales auxquelles le confinement semble avoir invité (développement du télétravail, management plus déconcentré, etc.) – une décision curieuse, dans la mesure où le recrutement de managers temporaires et dédiés à de tels chantiers ne permet pas de créer le vécu commun qui permet l’engagement.
Quoiqu’il en soit, l’exemple du management de transition illustre à quel point la crise de la Covid-19 a bouleversé la posture du manager.
Au cœur de la tempête, certains managers ont pris conscience de leur rôle de capitaine. Une posture sur laquelle tous n’étaient pas à l’aise. Certains se sont révélés, d’autres ont compris que ce n’était pas leur tasse de thé. Mais dans tous les cas, il aura fallu s’adapter, comme l’a expliqué le Directeur général adjoint du Territoire de Belfort, Remy Berthier, dans un édito on ne peut plus juste à la Gazette des communes en juillet dernier.
« Au plus fort de la crise, il avait endossé la figure du skipper d’un voilier pris dans la tempête, qui rassure et décide malgré le contexte incertain, puis assume et ajuste autant que de besoin. Il s’est ensuite investi dans les questions organisationnelles et sanitaires liées à la reprise des activités (1). Il doit maintenant, et beaucoup ne s’y attendaient pas, se poser en « facilitateur-rassembleur » et entrer dans le champ de l’intelligence émotionnelle. », Remy Berthier, Vice-Président de l’Association des Administrateurs Territoriaux de France (AATF), DGA Département du Territoire de Belfort
Parmi les compétences (re)découvertes, donc, l’intelligence émotionnelle. « La revoilà », me direz-vous ! Mais différemment cette fois, dans la mesure où elle prend toute sa place dans la démarche de résilience à laquelle se prêtent désormais les organisations.
Là encore, le risque est celui du mot valise. Mais force est de constater que la résilience n’est plus un simple concept rhétorique.
En effet, comme on l’a rappelé dans le Billet du manager dédié au déconfinement, l’un des enjeux actuels des managers (et des organisations, d’une façon générale) est de réussir à accompagner les collaborateurs dans cette démarche. Emprunté à l’anglais et issu du latin resilire qui signifie « rebondir », « rejaillir », la résilience désigne l’aptitude d’un individu à se construire et à vivre de manière satisfaisante en dépit de circonstances traumatiques. Et c’est peu dire que la crise sanitaire a eu un impact psychologique particulièrement important, sans compter que de sanitaire, la crise semble de plus en plus se muer vers une crise économique – certains y voient même un risque de crise des dettes souveraines.
« Oui-oui, vaillant et gentil »
En définitive, dans ce contexte incertain et complexe, y a-t-il un management qui garantisse l’engagement des collaborateurs ? Ce serait tellement plus simple s’il y avait une recette toute faite ou une baguette magique…

Cet article et les précédents (Engagez-vous qu’ils disaient ! et Combien tu m’aimes ? Mesure et limite de l’engagement collaborateur) n’ont d’autre vocation que de partager des pistes de réflexion. Beaucoup d’entre nous, jeunes et moins jeunes, avons un jour eu l’occasion de faire un pas de côté et d’interroger nos propres pratiques managériales. Souvent, cela a pu rendre encore plus cruelle la vérité de l’exercice : le manager est et reste au cœur des contradictions (que subissent les organisations elles-mêmes, du reste). Souvent aussi, les défis et la complexité de l’exercice apparaissent alors démentiels : accélération du temps et des urgences, complexités juridiques et financières, évolution des techniques, mutations des métiers…
Sans compter que le modèle français du management est, comme on l’a vu, empreint de cette « logique de l’honneur » mise en lumière par le sociologue Philippe d’Iribarne. Les pratiques dominantes restent très marquées par une vision archaïque de la figure du leader : le manager est un leader et le leader est héroïque. Ces pratiques s’inscrivent dans une conception « monarchique » de l’exercice du pouvoir.
Bref, de quoi se retirer définitivement du métier et aller tranquillou traire des chèvres dans le Larzac.
Mais avant de raccrocher, pourquoi ne pas se pencher sur une alternative déjà évoquée dans un Billet précédent sous l’angle de la posture du « people servant » parfois adoptée en politique.
En l’occurrence, il s’agit de s’intéresser au servant leadership. D’ailleurs, beaucoup des concepts mis en pratiques ci et là, comme « l’organisation apprenante » et « l’intelligence émotionnelle », viennent conforter la posture du servant leadership qui présente l’avantage de réconcilier le manager avec une certaine éthique humaniste.
En fait de concept, le servant leadership émane des praticiens eux-mêmes puisque ce modèle de management a été inventé par un chef d’entreprise américain, Robert Greenleaf, dans les années 1970. L’idée est toute simple : le manager se met au service de ses collaborateurs. Autrement dit, sa mission principale est d’aider ses collaborateurs et de leur donner les conditions nécessaires pour qu’ils s’accomplissent et qu’ils s’élèvent. Il le fait en adoptant des postures d’écoute et de dialogue, en essayant d’instaurer un climat de confiance, en délégant et en responsabilisant les collaborateurs, en les encourageant à prendre des initiatives et à faire preuve de créativité.
En somme, le servant leadership ramasse un peu tout ce qu’on a pu identifier et encourager en matière d’innovation managériale.
On voit bien comment il s’oppose à la conception occidentale traditionnelle du management charismatique et visionnaire. On est éloigné de la figure de l’homme providentiel, ce qui implique qu’on soit au clair avec son égo bien sûr.
Est-ce que ça marche, me direz-vous ?
Eh bien lorsque l’on met en regard les coûts cachés qui résultent des pratiques traditionnelles de management d’une part, comme le désengagement des collaborateurs, et le niveau de bien-être auquel conduit cette approche d’autre part, « la réponse elle est vite répondue » comme dirait l’autre.
Si les études montrent la performance supérieure du servant leadership, le succès est conditionné à la capacité des collaborateurs de se faire aider par leur manager. Or comme on l’a vu, nous sommes encore très imprégnés de la figure archaïque du manager, ce qui vaut donc aussi pour la façon dont nos collaborateurs peuvent nous percevoir. On m’a récemment rapporté l’anecdote d’un collaborateur qui a dû apprendre à dire « merci » à son manager et qui a compris, ce faisant, que dire « merci » vaut dans les deux sens.
Et pour faire écho à ce qu’on évoquait sur l’exercice d’autorité, il est entendu que le servant leader n’est pas un « Oui-Oui, vaillant et gentil ». Même lorsqu’elle est la posture « par défaut » du manager (ce qui est quand même bien moins épuisant que de devoir constamment chercher à « mériter » un morceau de confiance !), la confiance du servant leader peut se retirer – ponctuellement ou définitivement. Eh oui : le servant leader est aussi capable de sanctionner si on tire trop sur la ficelle.
Pour conclure, n’oublions pas non plus dans l’équation la responsabilité sociétale du management : mal traiter les collaborateurs au bureau a un impact sur le niveau de bienveillance ou de violence globale d’une société et sur la vision globale de la vie collective. Manager différemment, par exemple en exerçant une posture de servant leadership, c’est donc se donner le pouvoir de militer pour un autre modèle de société.
A bon entendeur… 😊


POUR EN SAVOIR PLUS :
« Introduction à la pensée complexe », Edgar Morin, première édition parue en 1990 chez ESF Editeur
« La logique de l’honneur. Gestion des entreprises et traditions nationales », Philippe d’Iribarne, paru en 1989 aux Editions du Seuil
« Le « servant leadership » : un paradigme puissant et humaniste pour remédier à la crise du management », Daniel Belet, Association de Recherches et Publications en Management, 2013
« Le servant leadership: un levier de management mais aussi de rentabilité pour l’entreprise », Vincent Giolito, Harvard Business Review, 2020
« Arrêter de tout miser sur l’intelligence émotionnelle », Emeric Kubiak, Harvard Business Review, 2020
« Ethique et MBA: Enquête sur les valeurs des étudiants en management », Hans Schlierer et Damien Richard, theconversation.com, 2020
« Les Narcisse. Ils ont pris le pouvoir », Marie-France Hirigoyen, Éditions La Découverte, 2019
« La Grande enquête managériale », Dossier réalisé par Emilie Baudet du Cabinet Cap Nova pour La Lettre du Cadre, décembre 2018
« L’incompétence professionnelle et sociale, première cause d’une mauvaise ambiance au travail« , Angela Sutan et Ludivine Martin, theconversation.com , 2019
« Autonomie et contrôle : les deux faces d’une même pièce », Eric Delavallée, questions-de-management.com, 2020